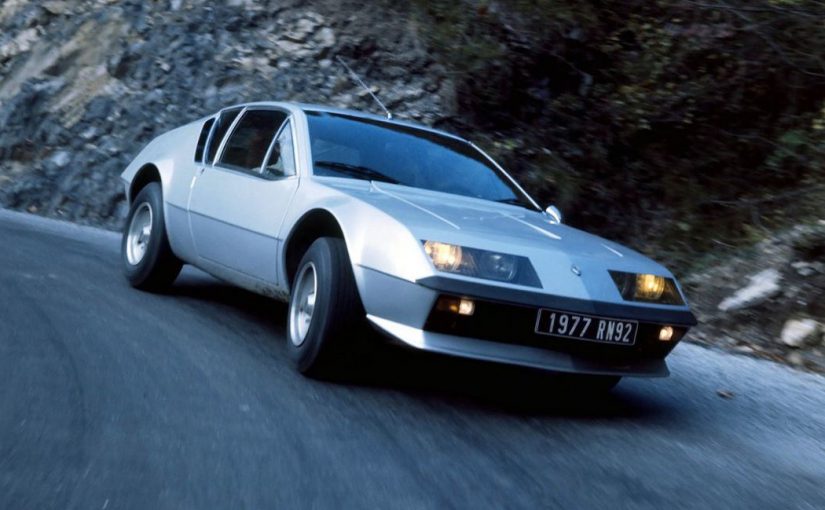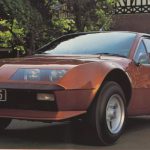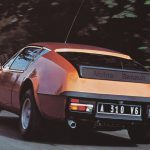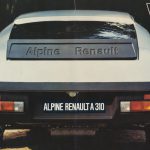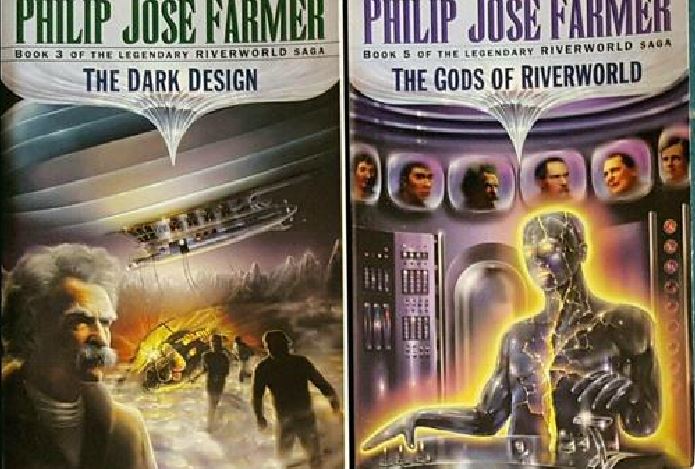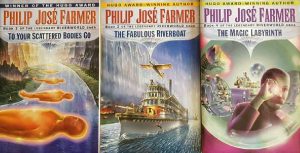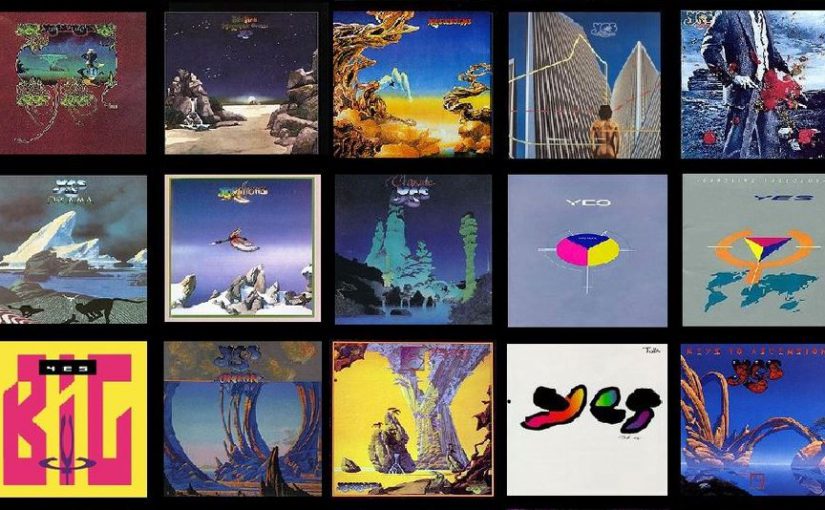L’enfance :
Alain Édouard Kienastn naît le 27 mai 1944 à Casablanca, dans une famille aisée d’origine suisse du côté maternel. Il porte d’abord le nom de son père officiel avant de prendre celui de son père biologique, Pierre Souchon (un agrégé d’anglais, qui est interprète pour les armées française et américaine au Maroc). Il vit six mois à Casablanca au Maroc, puis passe son enfance à Paris et sept ans dans une pension en Suisse.
En 1959, son père meurt dans un accident de voiture. Cette disparition le marquera profondément et inspirera deux chansons, « Dix-huit ans que je t’ai à l’œil » parue en 1977 sur l’album Jamais content et « La Ballade de Jim » parue en 1985 sur l’album C’est comme vous voulez en 1985.
« On ne se remet jamais de la disparition d’un père. Je suis un être à qui il manque un doigt depuis quarante ans et qui est enchaîné à son passé. Je me demande toujours ce que mon père aurait pensé de moi. Est-ce que je suis à la hauteur ? Avec le temps, le manque s’estompe et ça devient un moteur. Mais il n’y a plus de protecteur. Ce sont donc aujourd’hui mes chansons qui me protègent sinon je serais à la dérive, peut-être même mort. » (France-soir, 03/09/05)
Élève distrait et rêveur, il a des résultats scolaires calamiteux, si bien qu’il est envoyé à quinze ans en pension dans l’École d’horlogerie de Cluses en Haute-Savoie (actuellement lycée Charles-Poncet) où son frère aîné, professeur d’anglais, est aussi guide de montagne. La famille connaît des difficultés financières et sa mère doit gagner sa vie en écrivant pour la collection Harlequin. Ne pouvant s’adapter au milieu des autres élèves, il se réfugie dans la poésie et finit par se faire renvoyer pour indiscipline. Il est envoyé par sa mère en 1961 dans un lycée français en Angleterre. Son inscription n’étant pas valide, il reste néanmoins sur place et y vit de petits boulots pendant dix-huit mois. C’est notamment en travaillant dans un pub qu’il développe son goût pour la chanson populaire. Surnommé le Frenchman, certaines de ses rencontres lui donnent l’occasion de faire découvrir la chanson française (Georges Brassens, Guy Béart…) et lui permettent d’écouter du répertoire anglo-saxon. Il évoque ce passage de sa vie dans Londres sur Tamise sur l’album J’ai dix ans et dans la chanson « Jamais content ». Il rate son baccalauréat par correspondance trois fois.
Rentré en France, il vit encore de petits boulots et tente sa chance dans la chanson en se produisant dans des salles parisiennes. En mai 1968, il choisit de quitter Paris.
Les débuts :
Il écrit en 1973 la chanson « L’amour 1830 » qu’il destine à Frédéric François. Bob Socquet, directeur artistique de RCA Records, encourage Alain à l’interpréter lui-même. Elle reçoit un bon accueil et est sélectionnée au concours de la Rose d’or d’Antibes, où Alain emporte le prix spécial de la critique et le prix de la presse.
La rencontre avec Voulzy et le succès :
J’ai 10 ans (1974) : Dans la foulée, il enregistre un album. Cherchant un arrangeur capable de donner forme à son univers musical, il rencontre en 1974 Laurent Voulzy, également sous contrat chez R.C.A. Bob Socquet sent que la collaboration entre les deux hommes peut être fructueuse, les musiques étant le point faible des chansons de Souchon. Souchon et Voulzy seront liés depuis ce jour par leur amitié et leur complémentarité artistique. Laurent Voulzy réalise les arrangements du premier album d’Alain Souchon Petite annonce, rebaptisé quelques années plus tard J’ai dix ans, puis les musiques de Bidon sorti en 1976.
Bidon (1976) : Après le succès de J’ai dix ans, deux ans auparavant, Alain Souchon réédite l’exploit avec un second album, dans la même lignée que le précédent avec des titres comme Bidon et S’asseoir par terre. Si Laurent Voulzy compose toujours les titres de l’album (sauf quatre titres), Michel Jonasz apporte sa contribution en signant la musique de la chanson « Le monde change de peau » alors que Souchon compose trois chansons de l’album.
«Y a eu un déclic, décode Souchon. Les musiques syncopées un peu anglaises de Laurent m’ont obligé à trouver mon style. L’alexandrin classique ne convenait pas. Il me fallait bousculer la syntaxe, faire se heurter les mots, aller chercher l’argot, l’anglais, qu’il y ait un charme et une compréhension immédiate, et, bien sûr, que les textes reflètent mon regard sur le monde.»
Jamais content (1977) : Alors que Rockollection dont il signe le texte pour Laurent Voulzy est le succès de l’été 1977, Alain Souchon sort son troisième album : Jamais content. Il révèle Souchon sous un jour différent : empreint des difficultés de son époque (La p’tite Bill et Poulaillers’ Song), mais aussi comme le révélateur des transformations sociétales alors en cours avec « Allo Maman Bobo ». Il est alors en couverture des magazines, le symbole du Nouveau Père, plus fragile et plus conscient de sa part de féminité. Et déjà la mélancolie avec « Y’a de la rumba dans l’air » qui, entre émergence du punk et l’apogée du disco, apporte un vent de douceur acidulée et fait un gros succès. Il entame une tournée qui l’amène à être en première partie de Jean-Jacques Debout (Olympia), Antoine et Thierry Le Luron.
Toto 30 ans, rien que du malheur…(1978) : Le mythe du Nouvel Homme se confirme, angoissé par les années qui passent et les kilos qui viennent (Toto 30 ans rien que du malheur… et Papa mambo). Un album résolument plus noir que les précédents, où l’artiste se révèle de plus en plus introspectif (Le dégoût et J’étais pas là), mais qui n’en oublie pas pour autant la société et ses travers dans « Le Bagad de Lann-Bihoué ». Y figure également la chanson-titre du film de François Truffaut « L’Amour en fuite », que le réalisateur lui a demandée, l’une des plus appréciées du répertoire de l’auteur.
Rame (1979) : Alors qu’en 1979 il voit pour la première fois son nom écrit en lettres capitales rouges au fronton de l’Olympia, 1980 voit la sortie de Rame. La chanson-titre est un canon et un succès immédiat auprès du public. La même année il fait sa première apparition au cinéma devant les caméras de Claude Berri pour Je vous aime aux côtés de Catherine Deneuve et Serge Gainsbourg. La vie, vue comme un film de cinéma, lui inspire Manivelle sur l’album Rame.
D’autres films suivront, comme Tout feu, tout flamme de Jean-Paul Rappeneau et L’Été meurtrier de Jean Becker, deux films où il donne la réplique à Isabelle Adjani. Il emballe critiques et public, mais ne se sent pas à l’aise dans ce nouveau costume, et finira par renoncer à faire carrière dans le 7e art.
On avance (1983) : Le sixième album dresse déjà le bilan des années hippies dans « Lennon Kaput Valse » et se moque de la tension nouvelle des relations Est/Ouest dans « Billy m’aime ». Laurent Voulzy est moins présent sur cet album : il n’y signe qu’une seule musique, les autres sont dues à Souchon lui-même, Michel Jonasz (à qui il rend hommage dans le titre Jonasz sur l’album Rame), Louis Chedid, et Yves Martin, lequel a coproduit l’album. David McNeil met en mots avec Souchon la ville qui a vu sa naissance dans Casablanca, titre nostalgique. Cet album contribue à écorner le mythe du Nouveau Père, avec son univers musical décalé (orchestre, cordes, valse…). La même année il signe des textes pour Laurent Voulzy, pour son album : Bopper en larmes sorti en 1983.
C’est comme vous voulez (1985) : annonce la couleur dès la pochette : noire. Mâchoire serrée et regard « jamais content » : Souchon n’est pas d’humeur badine. Changement radical, à la fois de maison de disques (Virgin au lieu de RCA), comme de style musical, nettement plus rythmé et synthétique. Il regrette la lourdeur de la vie citadine (La vie intime est maritime et Pays industriels), se pose en chanteur cynique prêt à tout pour son succès (C’est comme vous voulez), avant de se chercher en vain (Les jours sans moi). Les radios préfèrent « La Ballade de Jim » qui évoque pourtant une tentative de suicide. Le clip recevra la Victoire de la musique du meilleur vidéo-clip de l’année 1986, alors que « Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante » reçoit celle de la chanson originale de l’année. Il part dans une tournée commune avec Véronique Sanson.
Ultra moderne solitude (1988) : est en partie enregistré au Royaume-Uni. La chanson-titre et « Quand je serai K-O » (Victoire de la musique de la meilleure chanson originale de l’année 1990) sortent en 45 tours et restent des standards de l’artiste. Cet album se distingue du précédent en ce qu’il est formellement moins noir, ce qui n’empêche pas Alain Souchon de dénoncer de plus en plus les dysfonctionnements de la société (Les cadors et Normandie Lusitania) ou de continuer à évoquer ses doutes existentiels (J’attends quelqu’un) et son angoisse du temps qui passe (La beauté d’Ava Gardner). Il décrit son album comme étant « très strict, austère, un peu monacal. La tournée qui s’ensuit donne l’album live Nickel qui reçoit la Victoire de la Musique du meilleur album de l’année 1991, de même que « Belle Île en Mer, Marie Galante » est sacrée « Chanson de la décennie ».
C’est déjà ça (1993) : est le 9e album studio d’Alain Souchon. L’album, qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires (disque de diamant) et a reçu plusieurs récompenses, est un énorme succès public et critique, et le premier extrait « Foule sentimentale » en est la preuve flagrante. Ce titre devient un tube essentiel du répertoire du chanteur mais aussi de la chanson française. Il reçoit le prix de meilleure chanson de l’année aux Victoires de la musique de 1994 et est élue meilleurs chanson des vingt dernières années aux 20e Victoires de la musique en 2005. Cet album évoque des thèmes de société de façon plus aiguë que d’habitude. Néanmoins, les textes de Souchon ne perdent rien de leur poésie particulière et de leur couleur tout en douceur. Un des titres de l’album, « Le Fil », est co-signé par Pierre Souchon, son fils. Pour ce disque, Alain Souchon s’est remis à la composition et a fait une place plus large à la guitare dont le son domine l’ensemble.
Au ras des pâquerettes (1999) : Prenant exemple sur son compère Laurent Voulzy, Alain Souchon raréfie sa production et attend 1999 pour sortir Au ras des pâquerettes, titre homonyme, bien que différent, de celui figurant sur le premier album des Cherche Midi de son fils Pierre. Cet album très attendu confirme la tendance amorcée depuis un ou deux albums d’un artiste qui nous raconte la vie ordinaire (Pardon, Rive Gauche à Paris). Son « engagement » dans les problèmes de la société affleure toujours (Petit tas tombé). Le livret de l’album contient des indications quant à la genèse des différentes chansons qui le composent. La tournée donnera l’occasion de capter pour la première fois un de ses concerts au Casino de Paris, qui donnera un album live et un DVD nommé J’veux du live.
La Vie Théodore (2005) : Son onzième album sort en 2005 sous le titre de La Vie Théodore, en hommage à Théodore Monod, dont il narre la vie dans la chanson-titre.
Écoutez d’où ma peine vient (2008) : Alain Souchon au départ ne voulait écrire que quelques chansons pour illustrer un documentaire sur sa carrière diffusé sur France 3 Le chanteur d’à côté, mais les chansons qu’il a écrites ont fini par former un album complet.
À cause d’elles (2011) : réalisé par Renaud Letang, reprend des airs que sa mère lui chantait quand il était enfant.
Alain Souchon & Laurent Voulzy (2014) : Le dernier album d’Alain Souchon est principalement composé de duos avec Laurent Voulzy.
Voir sur YouTube : « Alain Souchon – Les regrets (Clip officiel) » ; « Alain Souchon – La ballade de Jim (Clip officiel) » ; « Alain Souchon – Rive gauche (Clip officiel) » ; « Alain Souchon – La vie ne vaut rien (Clip officiel) » par Alain Souchon
https://www.youtube.com/watch?v=ojiv_MDHD7A
https://www.youtube.com/watch?v=qCsCeugXh70
https://www.youtube.com/watch?v=dArB8G_Y1kM