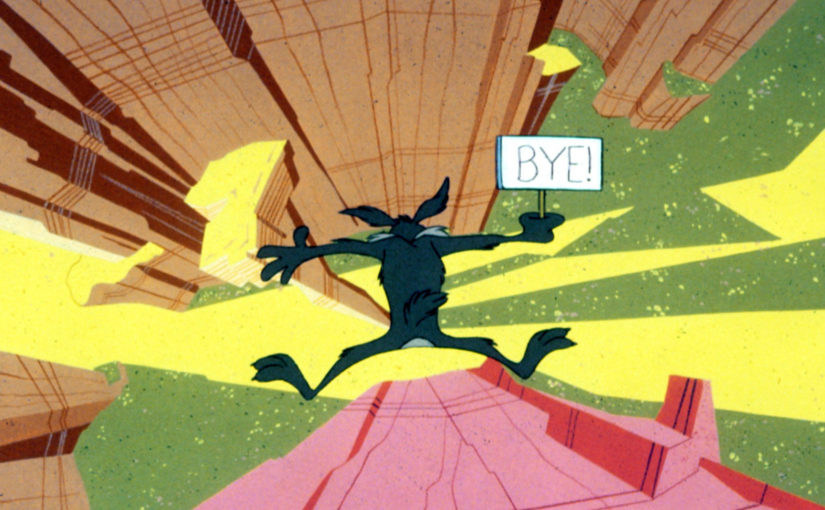Une fois n’est pas coutume, je vais parler ici d’un duo de mécaniques prestigieuses venues du pays du soleil levant parmi lesquelles figure une moto : la Yamaha V-Max. Certes, cette dernière fut commercialisée quatre ans avant la Honda NSX, mais j’ai été tenté d’associer les deux modèles sur cet article tant leur design et leur motorisation d’exception ont quasi simultanément fait montre d’une incontestable montée en gamme du savoir faire nippon en ce tout début des années 90. La quatre roue est une voiture à la silhouette superbe, présentée au Salon de Chicago de 1989, équipée d’un moteur VTEC de 274 ch, digne concurrente de la Ferrari 348. La deux roue quant à elle, est un merveilleux dragster des villes au style inimitable qui eut un succès notable sur la croisette dès son importation en France en 1986, et dont la plastique ravageuse est digne de figurer dans le Top 10 des merveilles du design contemporain.
Honda NSX Phase 1 (1990-1996) :

Même si sa gamme comprenait déjà quelques modèles vraiment sportifs, Honda n’avait pas encore exploité en 1989, la formidable publicité obtenue par les succès de son moteur en Formule 1. Il était pourtant tentant d’aller chasser sur les terres de Ferrari ou Porsche avec une vraie voiture de sport et ce feu vert fut donné à l’équipe du service de Recherche et de Développement dirigé par Nabuhico Kawamoto en 1988.
Le R&D se fixa deux objectifs prioritaires : équilibre entre puissance et comportement d’une part, meilleur rapport poids/puissance d’autre part. Le premier fit opter pour un moteur central arrière, le second pour une structure tout aluminium : la traverse portant le tableau de bord est la seule pièce de structure en acier et même les bras de suspension sont en alliage léger. La NSX est la première automobile de série à être basée sur un châssis monocoque en aluminium.
Le design :
Ken Okuyama s’est inspiré pour la NSX du concept MG EX-E présenté en 1985 au salon de l’automobile de Francfort, le groupe Austin Rover auquel MG appartenait depuis 1981 s’étant rapproché du constructeur nippon pour diverses collaborations. Ce qui définit le mieux la sportive de Honda est sans nul doute son profil. La ligne de caisse, plantée dans le bitume à l’avant de la voiture, suit la courbe imposée par la roue puis se prolonge d’un seul trait vers l’arrière où elle remonte pour masquer l’aileron. Ce dernier est un des atouts majeurs de la NSX. En effet, les éléments aérodynamiques imposés par les performances de la machine sont ici totalement camouflés dans la carrosserie.
De même, le refroidissement du moteur est assuré par deux prises d’air courant le long des portières mais aussi, et de façon plus discrète, par une prise d’air se situant à la base de la lunette arrière. Celle-ci fait intégralement partie du canopy, cette verrière inspirée des avions de chasse. Cette origine stylistique est également renforcée par sa peinture noire, donnant l’impression d’une bulle.
Ce souhait d’intégration, aussi bien aérodynamique que stylistique, s’accompagne de poignées de porte situées dans les montants mais également, sur les premiers modèles, de phares rétractables. À l’arrière, les feux sont en forme de bandeau et se prolongent sur les montants de l’aileron. Le troisième feu de stop est, quant à lui, inclus dans l’aile de l’aileron.
La mécanique :
Avec un empattement très long et un comportement légèrement sous-vireur, les réactions de la NSX sont parfois un peu paresseuses : rien de comparable avec celle que toute la presse lui opposa, la Ferrari 348. Le moteur Honda lui-même, malgré toute sa sophistication, n’est pas aussi vivant que celui de l’italienne, par contre la NSX marque un net avantage en facilité et confort de conduite. La NSX a disposé de deux motorisations différentes au long de ses évolutions, le C30A et le C32B. Ils étaient tous les deux assemblés à la main dans l’usine de Tochigi.
Le C30A est un V6 à 90° de 2977 cm3 disposant du système de distribution VTEC ainsi que de l’injection PGM-FI de la marque. Également, le C30A reçoit le nouveau système VVIS (Variable Volume Induction System) fonctionnant grâce à un collecteur d’admission spécifique, permettant d’augmenter la quantité d’air admise à partir de 4800 tr/min. Il développe 274 ch à 7 300 tr/min et 294 Nm à 5400 tr/min. La version équipée de la boîte automatique à 4 rapports ne développe, quant à elle, que 255 ch à 6 800 tr/min, pour un couple inchangé.
Le bloc est entièrement en aluminium tandis que les bielles sont en titane – une première pour une automobile de série. Les culasses, contrairement aux autres V6 de la marque, reçoivent chacune deux arbres à cames. Ces derniers actionnent les 24 soupapes du moteur.
Caractéristiques Techniques :
Production : 18.896 exemplaires.
Usine d’assemblage : Tochigi (Japon) (1990 – 2004)
Moteur et transmission : V6 DOHC VTEC 24 soupapes ; Cylindrée : 2977 et 3179 cm3 ; Puissance maximale : 274 puis 294 ch ; Automatique : 255 ch.
Transmission Propulsion : Moteur central arrière ; Boîte de vitesses manuelle 5 vitesses ou automatique 4 vitesses.
Poids et performances : Poids à vide 1350 à 1430 kg ; Vitesse maximale 273 km/h ; accélération 0 à 100 km/h en 5,9 s.
Châssis – Carrosserie : Coupé ou targa 2 portes ; Coefficient de traînée 0,32.
Dimensions : Longueur : 4425 mm ; Largeur : 1810 mm ; Hauteur : 1170 mm ;
Empattement : 2530 mm.
Prix du modèle neuf en 1990 : 495.000 F soit 121.106 € avec 60 % d’inflation sur la période.
Cote actuelle : à partir de 45.000 €.
Yamaha V-Max (1985-2007) :

Au milieu des années 80, John Reed, un Anglais expatrié en Californie, fut engagé par Yamaha pour concevoir ce qu’elle imaginait être « The Ultimate Custom Bike ». À l’origine, la V-Max devait être distribuée uniquement sur les marchés américain et japonais. Mais l’importateur français, Jean-Claude Olivier convainquit les dirigeants de Yamaha de lui vendre une dizaine de V-Max. Il eut l’idée de faire rouler ces motos pendant l’été sur un lieu très fréquenté : Saint-Tropez. Le coup de publicité fut une réussite, les commandes affluèrent et la direction décida de distribuer la V-Max en Europe en 1986.
Phénomène de mode au départ, elle deviendra par la suite une légende qui n’a pas pris une ride au fil du temps. Ce dragster des villes réunit, il faut l’avouer, un bon nombre de qualités dans ce genre à part. Monstrueuse avec son énorme moteur V4 de 1200 cm3 exposé à tous les regards, elle est la reine des départs canon et ne rechigne pas à faire patiner son pneu arrière extra large, mais elle sait aussi se faufiler et reprendre aux plus bas régimes en cinquième. Provocante avec ses deux grosses écopes en aluminium pour gaver d’air les quatre carburateurs et ses instruments de contrôle sur le réservoir, elle affiche son agressivité tout en gardant des lignes sobres et de grande classe. Performante, elle ne demande qu’à monter en régime et faire chanter ses deux volumineux échappements chromés sans pour autant assourdir l’entourage. Elle représente la puissance à l’état brut domptée par toute la sophistication du top de la technique de cette époque.
La 1200 VMax est restée au catalogue du constructeur pendant 21 ans ; pendant cette période, elle n’a reçu que très peu de modifications.
Caractéristiques Techniques : Voir brochure ci-dessous.
Prix du modèle neuf en 1991 : 63.500 F soit 15.536 € avec 60% d’inflation sur la période.
Prix d’occasion : à partir de 3500 €.