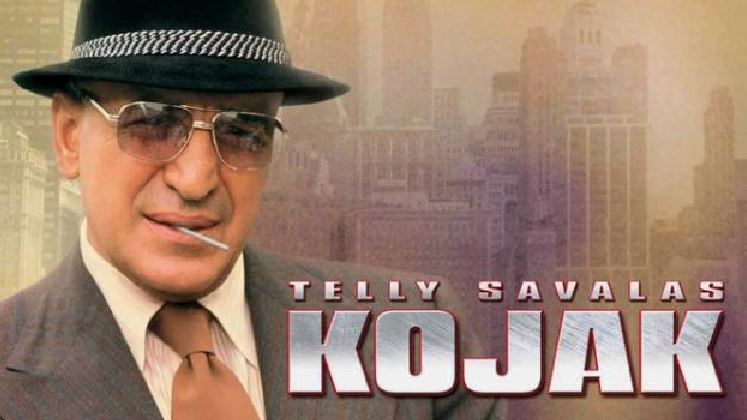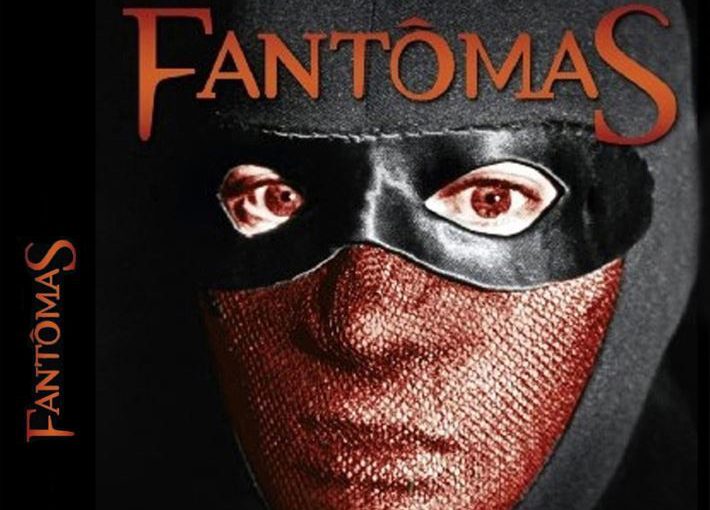La Série TV :
Arsène Lupin est une série télévisée en 26 épisodes de 55 minutes, créée d’après le personnage de Maurice Leblanc, coproduite en France par Jacques Nahum pour l’ORTF, et diffusée entre le 18 mars 1971 et 16 février 1974 sur la deuxième chaîne de l’ORTF. Inspirée de l’œuvre de Maurice Leblanc, elle relate les aventures d’un gentleman-cambrioleur et redresseur de torts à ses heures. En pleines années folles, Arsène Lupin (Georges Descrières), assisté de son fidèle Grognard (Yvon Bouchard), use de déguisements et change d’identité pour commettre ses délits. Accomplissant ses forfaits sans la moindre violence, il peut aussi bien dérober des joyaux, des toiles de maîtres que les plans d’un aéroplane révolutionnaire. A ses trousses, le commissaire Guerchard (Roger Carel) et même Herlock Sholmès (Henri Virlojeux) ne parviennent jamais à l’arrêter. Comme le dit la phrase devenue célèbre, « ce n’est pas un aristocrate qui vit comme un anarchiste, mais un anarchiste qui vit comme un aristocrate. »
Georges Descrières, de son vrai nom Georges René Bergé, est mort le 19 octobre 2013 à Cannes à l’âge de 83 ans.
L’œuvre de Maurice Leblanc :
Maurice Leblanc (1864-1941) est le deuxième enfant d’Émile Leblanc, armateur de trente-quatre ans, et de Mathilde Blanche, née Brohy, âgée de vingt et un ans. Il refuse la carrière que son père lui destine dans une fabrique de cardes et « monte à Paris » pour écrire. D’abord journaliste, puis romancier et conteur (Des couples, Une femme, Voici des ailes), il éveille l’intérêt de Jules Renard et d’Alphonse Daudet, sans succès public. Il fréquente les grands noms de la littérature à Paris : Stéphane Mallarmé ou Alphonse Allais. En 1901, il publie L’Enthousiasme, roman autobiographique.
En 1905, Pierre Lafitte, directeur du mensuel Je sais tout, lui commande une nouvelle sur le modèle du Raffles d’Ernest William Hornung : L’Arrestation d’Arsène Lupin. Deux ans plus tard, Arsène Lupin est publié en livre. La sortie d’Arsène Lupin contre Herlock Sholmès mécontente Conan Doyle, furieux de voir son détective Sherlock Holmes (« Herlock Sholmès ») et son faire-valoir Watson (« Wilson ») ridiculisés par des personnages parodiques créés par Maurice Leblanc.
Qui est Arsène Lupin ? par Maurice Leblanc (Le Petit Var, samedi 11 novembre 1933) :
Comment est né Arsène Lupin ?
De tout un concours de circonstances. Non seulement je ne me suis pas dit un jour : je vais créer un type d’aventurier qui aura tel et tel caractère, mais je ne me suis même pas rendu compte tout de suite de l’importance qu’il pouvait prendre dans mon œuvre.
J’étais alors enfermé dans un cercle de romans de mœurs et d’aventures sentimentales qui m’avaient valu quelques succès, et je collaborais d’une manière constante au Gil Blas.
Un jour, Pierre Lafitte, avec qui j’étais très lié, me demanda une nouvelle d’aventures pour le premier numéro de Je sais tout qu’il allait lancer. Je n’avais encore rien écrit de ce genre, et cela m’embarrassait beaucoup de m’y essayer.
Enfin, au bout d’un mois, j’envoyais à Pierre Lafitte une nouvelle où le passager d’un paquebot de la ligne Le Havre – New York raconte que le navire reçoit au large, et en plein orage, un sans-fil annonçant la présence, à bord, du célèbre cambrioleur Arsène Lupin, qui voyage sous le nom de R… À ce moment, l’orage interrompt la communication. Inutile de dire que la nouvelle met tout le transatlantique sens dessus dessous. Des vols commencent à se produire. Tous les voyageurs dont le nom commence par un R sont soupçonnés. Et c’est seulement à l’arrivée qu’Arsène Lupin est identifié. Il n’était autre que le narrateur même de l’histoire, mais comme son récit était fait d’une façon tout objective, aucun des lecteurs, parait-il, n’avait pensé un instant à porter ses soupçons sur lui.
L’histoire fit du bruit. Pourtant, lorsque Lafitte me demanda de continuer, je refusai : à ce moment-là, les romans de mystère et de police étaient fort mal classés en France.
J’ai tenu bon pendant six mois, mais, malgré tout, mon esprit travaillait. D’ailleurs, Lafitte insistait, et, lorsque je lui faisais remarquer qu’à la fin de ma nouvelle j’avais coupé court à tout développement ultérieur, en fourrant mon héros en prison, il me répondait tranquillement
– Qu’à cela ne tienne… qu’il s’évade !
Il y eut donc un second conte, où Arsène Lupin continuait à diriger des « opérations » sans quitter sa cellule ; puis un troisième où il s’évadait.
Pour ce dernier, j’eus la conscience d’aller consulter le chef de la Sûreté. Il me reçut très aimablement et s’offrit à revoir mon manuscrit… mais il me le renvoya au bout de huit jours, avec sa carte et sans un commentaire… Il avait dû trouver cette évasion complètement impossible !…
Et, depuis, je suis le prisonnier d’Arsène Lupin ! L’Angleterre, d’abord, a traduit ses aventures, puis les États-Unis, et maintenant, elles courent le monde entier.
L’épigraphe « Arsène Lupin, gentleman cambrioleur », ne m’est venue à l’esprit qu’au moment où j’ai voulu réunir en volume les premiers contes, et qu’il m’a fallu leur trouver un titre général.
Un de mes plus efficaces éléments de renouvellement pour les aventures d’Arsène Lupin a été la lutte que je lui ai fait soutenir contre Sherlock Holmes, travesti en Herlock Sholmès. Je peux, néanmoins, dire que Conan Doyle ne m’a nullement influencé, pour la bonne raison que je n’avais encore jamais rien lu de lui, lorsque j’ai créé Arsène Lupin.
Les auteurs qui ont pu m’influencer sont plutôt ceux de mes lectures d’enfant ; Fenimore Cooper, Assolant, Gaboriau, et plus tard, Balzac, dont le Vautrin m’a beaucoup frappé. Mais celui à qui je dois le plus, et à bien des égards, c’est Edgar Poe. Ses œuvres sont, à mon sens, les classiques de l’aventure policière et de l’aventure mystérieuse. Ceux qui s’y sont consacrés depuis n’ont fait que reprendre sa formule… autant qu’il peut être question de reprendre sa formule à un génie ! Car il savait, lui, comme nul ne l’a jamais tenté depuis, créer autour de son sujet une atmosphère pathétique.
D’ailleurs, ceux qui lui ont succédé ne l’ont généralement pas suivi dans ces deux voies, mystère et police ; ils se sont orientés surtout vers la seconde. Ainsi, Gaboriau, Conan Doyle et toute la littérature qu’ils ont inspirée en France et en Angleterre.
Pour moi, je n’ai pas cherché à me spécialiser ; toutes mes œuvres policières sont des romans mystérieux, toutes mes œuvres de mystère sont des romans policiers. Je dois dire que mon personnage même m’y a conduit.
La situation n’est, en effet, pas la même suivant que le personnage central est le bandit ou le détective. Lorsque c’est le détective, cela présente cet intérêt que le lecteur ne sait jamais où il va, puisqu’il est du côté du détective qui se trouve en face de l’inconnu. Au contraire, lorsque le récit tourne autour du bandit, on connaît d’avance le coupable, puisque c’est justement lui.
D’autre part, j’ai dû faire d’Arsène Lupin un héros double, un homme qui soit à la fois un bandit et un garçon sympathique (car il ne peut y avoir de héros de roman qui ne soit sympathique). Il fallait donc ajouter à mon récit un élément humain pour faire accepter ses cambriolages comme des choses très pardonnables, sinon toutes naturelles. D’abord, il vole beaucoup plus par plaisir que par avidité. Ensuite, il ne dépouille jamais des gens sympathiques. Il se montre même parfois très généreux.
Enfin, ses exploits malhonnêtes sont souvent expliqués en partie par des entraînements sentimentaux qui lui donnent l’occasion de faire preuve de bravoure, de dévouement et d’esprit chevaleresque.
Dans Conan Doyle, Sherlock Holmes n’est animé que du désir de résoudre des énigmes, et il n’intéresse le public que par les moyens qu’il emploie pour y parvenir. Arsène Lupin, au contraire, est continuellement mêlé à des événements qui, le plus souvent, lui tombent dessus sans qu’il sache même pourquoi, et dont il doit sortir avec honneur… c’est-à-dire un peu plus riche qu’avant. Lui aussi se jette dans des aventures pour découvrir la vérité ; seulement cette vérité il l’empoche.
Cela ne signifie d’ailleurs pas qu’il se pose en ennemi de la société. Au contraire, il dit de lui-même : « Je suis un bon bourgeois… Si on me volait ma montre, je crierais au voleur. » Il est donc, par goût, sociable et conservateur. Seulement, cet ordre qu’il juge nécessaire, qu’il approuve même, son instinct le pousse sans cesse à le bouleverser. Ce sont ses remarquables dons à « barboter » qui l’amènent fatalement à être malhonnête.
Mais il est, dans ses aventures, un autre élément d’intérêt important et qui me semble avoir le mérite de l’originalité. Je ne m’en suis pas rendu compte non plus tout de suite. D’ailleurs, en littérature on ne prévoit jamais ce que l’on doit faire : ce qui vient de nous, se forme en nous et nous est souvent une révélation à nous-mêmes. Il s’agit dans le cas d’Arsène Lupin de l’intérêt que présente la liaison du présent, dans ce qu’il a de plus moderne, avec le passé, surtout historique ou même légendaire, il ne s’agit pas de reconstituer des événements d’autrefois en les romançant, comme dans Alexandre Dumas, mais de découvrir la solution de problèmes très anciens. Arsène Lupin est continuellement mêlé à de tels mystères par le goût qu’il a de ces sortes de recherches.
D’où cette série d’aventures d’Arsène Lupin où les faits sont contemporains mais où l’énigme est historique. Par exemple, dans L’Île aux trente cercueils, il s’agit d’un rocher entouré de trente écueils. On l’appelle la Pierre-des-rois-de-Bohême ; mais personne ne sait pourquoi. La tradition prétend seulement qu’autrefois on amenait des malades sur cette pierre et qu’ils guérissaient. Arsène Lupin découvre qu’un navire qui apportait ce rocher de Bohême a échoué là du temps des druides, et que les miracles dont on parlait étaient dus au radium que contenait cette pierre (on sait, en effet, que la Bohême en est la plus grande productrice).
Établir un roman d’aventures policières sur de telles données, élève forcément le sujet ; et c’est une des raisons, j’imagine, qui ont concouru à rendre populaire et attachante la personnalité de ce Don Quichotte sans vergogne qu’est Arsène Lupin.
Source
Episode : Les Anneaux de Cagliostro
Première diffusion : 27 mai 1971
À Vienne Lupin retrouve une vieille connaissance en la personne de la belle Tamara, une collègue et rivale. Tamara se fait passer pour la Comtesse Cagliostro, descendante du fameux mage. Elle recherche les anneaux de ce dernier car une énigme y est gravée, conduisant au légendaire trésor de l’Empereur Frédéric Barberousse. D’abord opposés, Lupin et Tamara font cause commune quand l’employeur de cette dernière tente de la doubler et de l’assassiner. Lupin sympathise également avec Georgine, adorable et gaffeuse journaliste, myope come une taupe. Elle se révèle être la fille du propriétaire légitime du magot. Finalement Lupin découvre la cachette avant tout le monde et remet le trésor à Georgine, non sans prélever sa part ! Il peut ensuite partir en voyage avec Tamara.