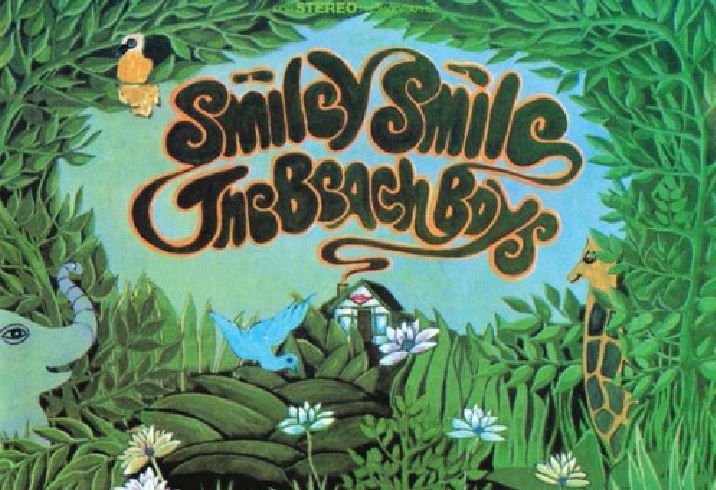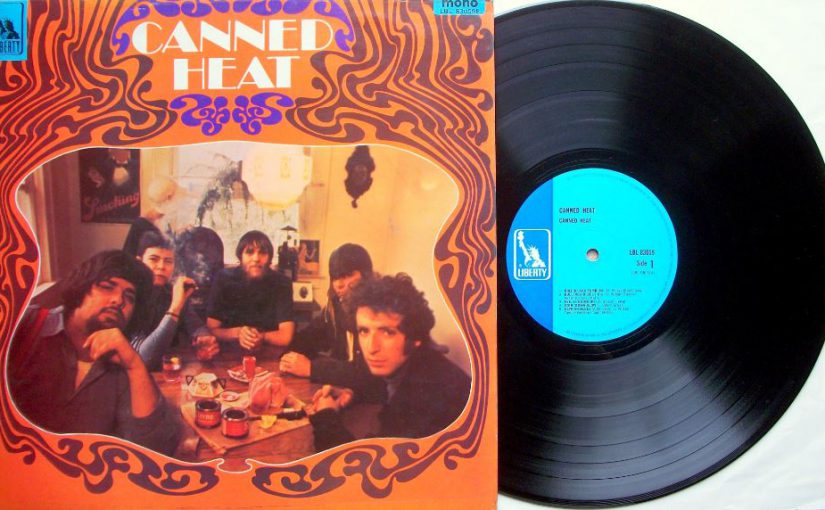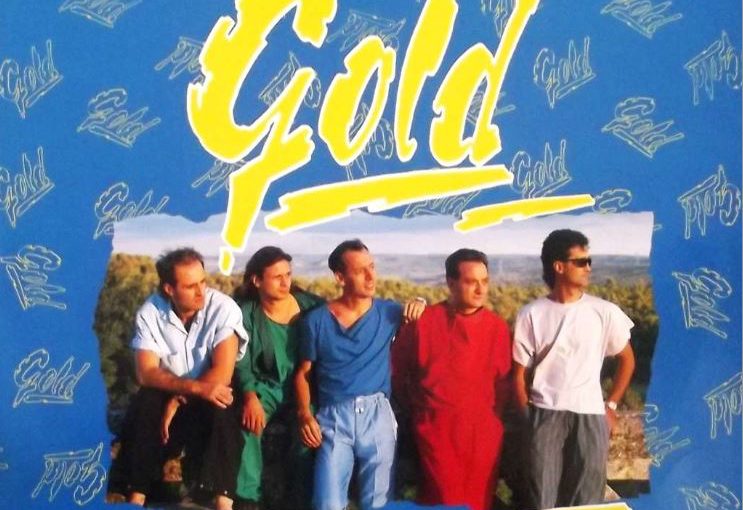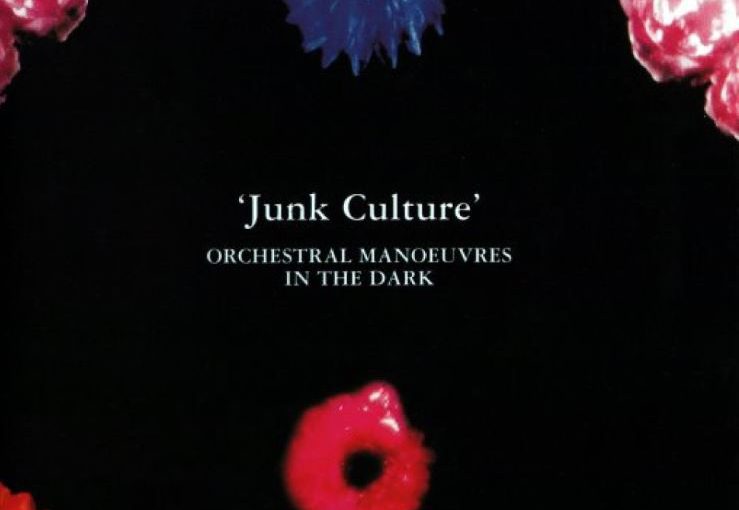Né le 24 mai 1941, de son vrai nom Robert Zimmerman, Bob Dylan est originaire du Minnesota, dans le Midwest américain. Tout jeune, il se passionne pour la musique et le personnage de Woody Guthrie. Le mythe de la route, amplifié par les écrits de Jack Kerouac, le pousse à plusieurs reprises à vagabonder. Mais le folk et les hobos ne sont pas ses seuls amours : en 1956, il découvre Presley comme tout le monde, et apprend à jouer le rock. Il reprendra la guitare électrique 8 ans plus tard. En attendant, il écrit des chansons et part à New York où la scène folk est alors importante, avec Pete Seeger, Dave van Ronk, entre autres. Il s’y fait très vite admettre, tout en se prétendant l’héritier du message de Woody Guthrie à qui il rend visite sur son lit d’Hôpital. Mais l’inspiration de Dylan se tourne déjà vers les poètes européens, le Gallois Dylan Thomas (à qui il a emprunté son prénom), le Français Arthur Rimbaud et l’anglais Emerson. Petit à petit, son propos se politise. Il devient l’un des ténors du protest song, avec des chansons dénonçant les marchants d’armes, la justice blanche, le chômage et la pauvreté, ou simplement la mort d’un boxeur. Son audience commence alors à s’étendre considérablement, en particulier dans les milieux étudiants qui en font une sorte de porte-parole.
La période Rock :
C’est vers cette époque qu’il rencontre Joan Baez avec qui il se lie pour deux années. Mais son inspiration change, sa pensée devient plus métaphysique, sa réflexion dépasse la simple contestation. Les amateurs de folk commencent à le lâcher, et le font définitivement le jour où il abandonne la traditionnelle guitare acoustique pour une guitare électrique et se fait accompagner par un groupe, le Butterfield Blues Band, au festival de Newport en 1965, puis le Band (alors Hawks) l’année suivante, en tournée. Les ponts sont rompus avec un certain milieu. Mais Dylan s’est acquis du même coup l’adhésion de l’énorme public adepte du Pop-Rock. Son revirement déclenche une série de rénovations : naissance du Folk Rock en Californie, intellectualisation des chansons en Angleterre. Les rapports entre Dylan et les Beatles sont, à ce titre, exemplaires.
Engagé à fond dans le rock, Dylan se consume littéralement. Il veut approcher toutes les formes de musique, embrasser toutes les philosophies, toucher à toutes les expériences. C’est l’époque de « Like a Rolling Stone », une période de tension, d’éruption interne. Plus il se cache, plus le mythe devient envahissant. Il perd un peu les pédales, et un accident de moto, en juillet 1966, le contraint à un an d’inactivité. Dans sa retraite de Woodstock, il lit beaucoup, travaille avec ses amis du Band et réapparaît, mûri, engagé dans une recherche apparemment plus mystique.
La période Country :
Le vedettariat, dont il ne veut pas, est sans doute en partie à l’origine des deux albums suivants, où l’on entend un Dylan à la voix plus grave (ex: « Lay Lady Lay » sur Nashville Skyline) que celle, si caractéristique, qu’on lui connaissait. Habillé façon cow-boy, il s’essaie à la musique country sentimentale et le double album Self Portrait, tout en ballades gentillettes et douces, consterne certains de ses admirateurs : leur idole semble abandonner la poésie de la contreculture pour devenir un tranquille père de famille, avec des préoccupations plus prosaïques. Nashville Skyline marque la rencontre de Dylan avec un autre monstre sacré de la chanson américaine, Johnny Cash. Les chansons « I Threw It All Away », leur reprise de « Girl from the North Country » participent à la réussite de l’album. L’album Self Portrait, composé en majeure partie de reprises de titres folk et pop, est plus hétérogène. On y trouve une autre version de ce qui est l’un de ses grands succès : « Like A Rolling Stone » ; ainsi que son interprétation de « Je t’appartiens » (« Let It Be Me »), (composé par Gilbert Bécaud sur des paroles françaises de Pierre Delanoë).
La période « Born-again » :
Cependant, il ne refait pas de concert avant 1973, année où il entreprend une grande tournée aux U.S.A. accompagné par le Band. En 1975 il décide de faire une petite tournée dans les clubs, avec ses copains. Cela prend rapidement de l’ampleur et finit dans des stades de 20.000 personnes. Toute l’affaire, la Rolling Thunder Revue (une idée de son ami Phil Ochs) est couchée sur pellicule et sort en 1978 sous le titre « Reanaldo and Clara ». La même année, un Dylan Rajeuni entreprend une tournée mondiale donnant six concerts à Paris au mois de juillet, et lorsqu’il paraît sur scène, c’est toujours le même charme, comme 15 ans plus tôt. En 1979, Dylan se convertit au christianisme et se met à écrire sobrement à propos de spiritualité, évoquant aussi sa relation avec Dieu. Si le premier disque de cette période, Slow Train Coming, avec notamment Mark Knopfler à la guitare, et Tim Drummond à la basse, se révèle remarquablement singulier (novateur dans son œuvre), les suivants sont plus traditionnels et les textes et les arrangements sont souvent inspirés du Gospel.
Bob Dylan a été introduit au Rock and Roll Hall of Fame en 1988. Il a obtenu le prix Nobel de littérature en 2016.
Quelques albums remarquables :
The Times They Are a-Changin’ (1964) : Dylan change de producteur, délaissant John Hammond au profit de Tom Wilson, et prend conscience qu’il est la voix d’une génération (« The Times They Are a-Changin' »). Ses attaques contre le système sont plus amères (« God on your Side »), plus désillusionnées (« Only a pawn in their Game »), et les chansons se font plus tendres, moins conventionnelles (« One Many Mornings »).
Bringing It All Back Home (1965) : C’est l’album de la rupture. Dylan est passé à l’électricité (une face) mais joue encore acoustique lorsqu’il le désire (l’autre face). C’est l’homme à deux visages, ici avec Joan Baez à ses côtés. Les textes ont un lyrisme échevelé, brouillon parfois, essayant de piéger la réalité en pensant plus vite qu’elle (« Subterranean Homesick Blues »). Il y a « Mr. Tambourine Man », bien sûr, en version acoustique, et quand il parle d’amour, c’est avec des mots d’une grande délicatesse (« Love Minus Zero/No Limit »).
Highway 61 Revisited (1965) : Parmi les musiciens qui l’accompagnent, on trouve Al Kooper au piano et à l’orgue, responsable du « son » des premiers Dylan électriques, et surtout Mike Bloomfield, dont les phrases de guitare, courtes, acérés, rebondissent sur les paroles de Bob Dylan (« Tomstone Blues »). « Like a Rolling Stone » ouvre cet album, le plus rock de tous ceux qu’il a réalisé.
Blonde on Blonde (1966) : Avec ce premier double album de l’histoire du rock, Dylan arrive au faîte d’une période difficile. Il est au bord de la catastrophe. Pourtant, jamais ses chansons n’ont été aussi émouvantes, jamais leur lyrisme n’a atteint de tels vertigineux sommets. Les images et les phrases s’entrechoquent. Les rapports avec les femmes apparaissent plus complexes que de banales déclarations d’amour (« I Want You », « Just Like a Women ») et les mots clefs abondent, qui sont autant de petits proverbes reflétant le climat du moment (« Rainy Day Women »).
Nashville Skyline (1969) : C’est le neuvième album de Bob Dylan, sorti chez Columbia Records. S’appuyant sur le style rustique qu’il a expérimenté avec John Wesley Harding, Nashville Skyline affiche une immersion complète dans la musique country. Avec les thèmes lyriques les plus basiques et ses structures de composition simples, Dylan (qui avait temporairement cessé de fumer) a étonné le public avec sa voix plus grave de crooner country. L’album a reçu une réaction généralement positive des critiques et a été un succès commercial arrivant à la 3ème place aux États-Unis ; ce fut également le quatrième album classé N°1 au Royaume-Unis.
Slow Train Coming (1979) : Imprévisible, comme à son habitude, Bob Dylan nous offre là un album inattendu – si l’on se réfère à ses dernières productions. La voix à retrouvé ses belles inflexions et la diction est compréhensible. Les musiciens sont ceux du groupe Dire Straits et des studios de Muscle Shoals (l’album est produit par Barry Beckett et Jerry Wexler, spécialiste de la Soul et du rythm and Blues). Autant d’atouts dans un jeu que rarement Dylan a bien tenu en main. Cette production d’une qualité exceptionnelle est teintée de prosélytisme catholique, religion à laquelle il vient de se convertir. Dans cet album, le jeune homme en colère, le poète révolté, le héros d’une génération de combattant de rue est devenu un homme rangé, ce qui dérange beaucoup de ses anciens admirateurs.
Discographie de 1962 à 1979 :
1962 : Bob Dylan
1963 : The Freewheelin’ Bob Dylan
1964 : The Times They Are a-Changin’
1964 : Another Side of Bob Dylan
1965 : Bringing It All Back Home
1965 : Highway 61 Revisited
1966 : Blonde on Blonde
1967 : John Wesley Harding
1969 : Nashville Skyline
1970 : Self Portrait
1970 : New Morning
1973 : Pat Garrett and Billy the Kid
1973 : Dylan
1974 : Planet Waves
1975 : Blood on the Tracks
1975 : The Basement Tapes
1976 : Desire
1978 : Street-Legal
1979 : Slow Train Coming
Voir sur YouTube : « Bob Dylan – Lay Lady Lay » par Post Productions ; « Bob Dylan – Subterranean Homesick Blues » par BobDylanVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=Go2jbER0wk0