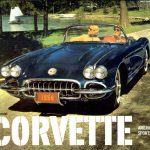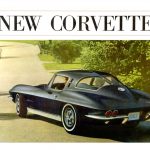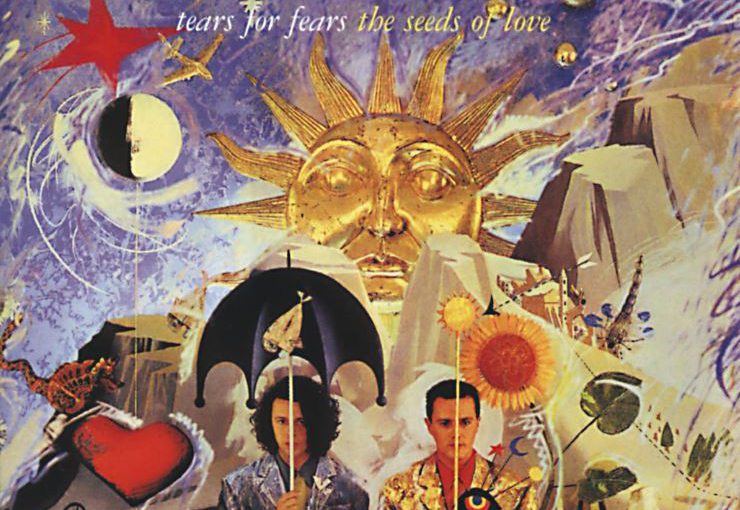Certaines voitures américaines sont encore auréolées d’une légende dont l’origine se perd dans un passé fabuleux. Ce ne sont plus des objets prestigieux, ce sont des institutions. La Corvette C4 est l’une d’elles, héritière de la somptueuse Corvette 1959, la « Chriscraft des boulevard », ou de l’agressive Stingray « Split Window » de 1963.
La Corvette C4 (1984-96) :
La Corvette de quatrième génération fut présentée en 1983 et ne fit l’objet que d’un léger lifting comparé au modèle C3 (sorti en 1968 et déjà très européanisé) qui avait eu pour redoutable honneur de prendre la succession de la fameuse Stingray, dont les ventes et la longévité avaient battu tous les records. En conséquence, ses lignes montraient un souvenir marqué du modèle précédent, avec sa proue développée, ses ailes fuselées et son étranglement central « en bouteille de Coca-Cola », sa vaste lunette arrière profilée et ses boucliers intégrés. Mais tout cela, assagi et affiné, dans un style plus fluide et moins musclé. La nouvelle version restait fidèle à la tradition sur deux points : comme toutes les Corvettes depuis trente ans, la carrosserie était en plastique, et il n’y avait pas de coffre à bagages à proprement parler (seulement un compartiment accessible de l’intérieur).
Sérieuse et compétente :
La nouvelle Corvette disait adieu au fameux V8 de 7,4 litres ; son V8 de 5,3 litres, étranglé par les normes antipollution des années 80, elle ne promettait au départ que 205 à 233 ch. C’était une machine sérieuse et compétente, respectueuse des normes, soucieuse de la sécurité et de l’environnement, conforme aux critères de sa clientèle aisée. En 1991, la puissance passe de 233 ch (1984) à 250 ch. En 1992, le V8 de 5,7 L qui développe 300 ch est couplé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou automatique à quatre rapports. En 1996, la Corvette pouvait disposer en option d’un moteur développant 330 ch. Entre 1990 et 1992, la version ZR-1 (non importée en France) disposait d’un moteur développant 375 ch, et de 1993 à 1995 inclusivement elle développera 405 ch. La production totale de cette génération est de quelque 330.000 exemplaires.
Un peu d’histoire : les modèles C1 et C2 :
La Corvette C1 (1953-62) : née en 1953, la Corvette de Chevrolet faillit disparaître à la fin de 1955 pour manque de résultat. Elle fut sauvée par l’apparition de la Thunderbird de Ford et, surtout, par un brillant V8 de plus de 200 ch. Ses lignes furent rajeunies deux fois, pour 1956 et 1958 tandis qu’elle perdait son caractère spartiate initial. En 1960, l’image de la Corvette était celle d’une luxueuse sportive comme le démontraient ses grandes dents chromées. En 1961, elle évolua encore. En 1958, le grand patron du style GM, Harley Earl prit sa retraite après plus de 30 ans de règne. William L. Mitchell, son second, prit sa place et remodela la Corvette 1960 selon des lignes plus élégantes, plus sobres, plus raffinées. Il retoucha l’arrière, plus tendu en « queue de canard », et l’avant, doté d’une grille quadrillée moins agressive.
La Corvette C2 (1963-67) [Stingray] : Au début des années 60, la voiture américaine, encore bien protégée des crises énergétiques, évolue doublement : d’une part, le style s’épure jusqu’à la sobriété après les excès chromés et les ailerons de la décennie précédente et, d’autre part, la course à la puissance s’intensifie encore, au point que les 350 ou 400 chevaux ne sont pas rares sous les capots. La nouvelle Corvette présentée fin 1962 en fait la synthèse pour devenir une classique absolue. Près de huit ans après son arrivée, le client américain est lassé de l’esthétique sensationnelle du modèle C1 et le muscle va désormais inspirer les lignes de la nouvelle Stingray dans laquelle force cachée sous le capot est presque palpable. Les courbes tendues de ce modèle signé Bill Mitchell, vont étonner et séduire des deux côtés de l’Atlantique. Un seul élément, critiqué, connaît une brève existence : la glace arrière à séparation centrale qui disparut au bout d’un an. La rareté de ces modèles, dits « Split Window », en a fait depuis les plus recherchés.
Caractéristiques Techniques :
Moteur : V8 ; Cylindrée : 5733 cm3 ; Soupapes en tête ; Puissance maximale : 205 à 405 ch ; Couple maximal : 461 Nm.
Transmission : Propulsion, 4 vitesses automatique, 6 vitesses manuelle.
Poids et performances : Poids à vide : 1505 kg ; Vitesse maximale : 225 à 294 km/h ; Accélération : 0 à 100 km/h en 4,5 à 6,2 s.
Carrosserie : Coupé.
Dimensions : Longueur : 4540 mm ; Largeur : 1790 mm ; Hauteur : 1180 mm.
Prix du modèle neuf en 1987 : Prix US : $ 32.038.
Prix du modèle Corvette C4 en occasion : à partir de 7000 €.