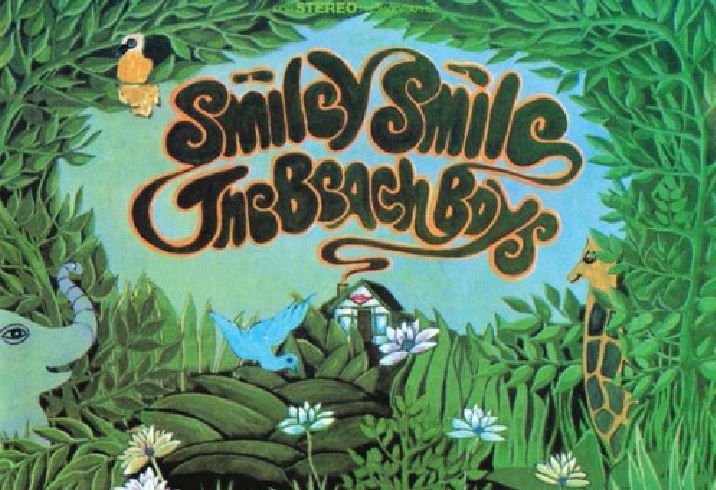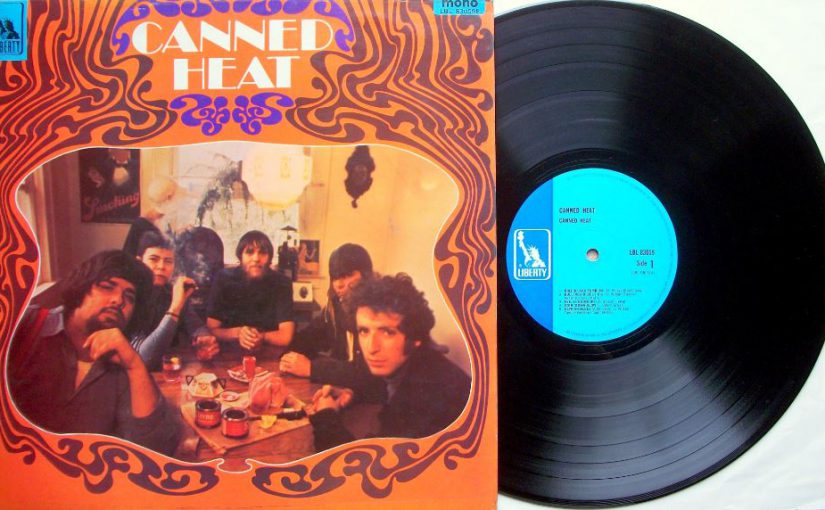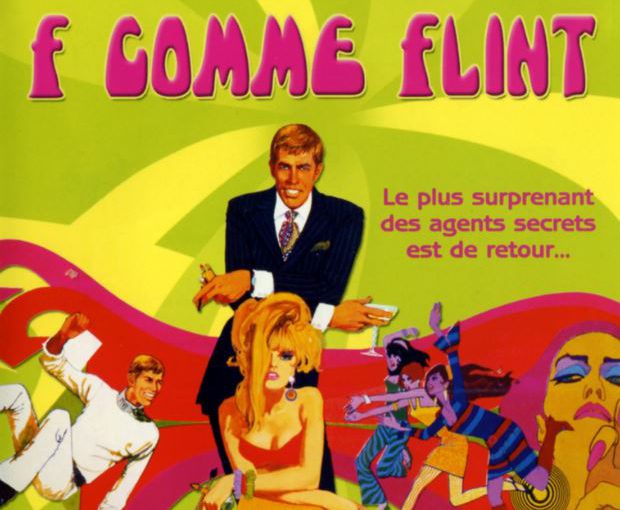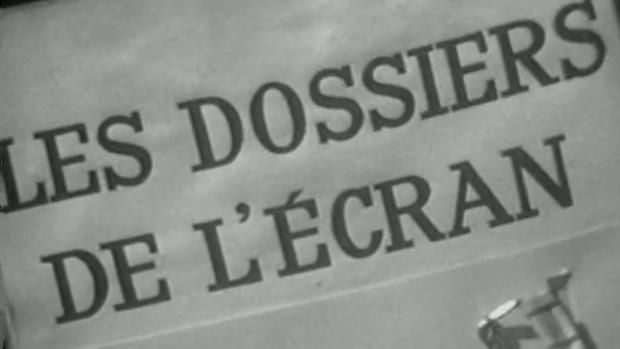On dit qu’ils ont inventé la Californie. Formé à Hawthorne (conté de Los Angeles) en 1961, le groupe des frères Wilson (Brian le compositeur, Carl le guitariste et Dennis le batteur) a longtemps rivalisé avec les Beatles pour découvrir des sonorités nouvelles. La renommée des Beach Boys commence dès 1961 lorsqu’ils écrivent une chanson à la gloire du surf (« Surfin' »). Vont suivre toute une série de succès dus à la fois à l’engouement provoqué par ce sport et à la qualité de leurs harmonies vocales. Autour du noyau initial, deux nouveaux venus : leur cousin, Mike Love, au chant, et un copain de classe, Alan Jardine, à la guitare.
Le groupe, dirigé par son auteur principal mais aussi producteur Brian Wilson, a lancé des approches novatrices sur la forme et la production de la musique pop, en combinant leurs affinités pour les groupes vocaux inspirées par le jazz, le rock and roll des années 1950 et le R & B noir avec des orchestrations originales et des techniques d’enregistrement non conventionnelles de manière innovante.
Leurs premiers succès s’intitulent : « Surfin’ Safari », « Surfin’ USA », « Surf City », « Surfer Girls »… Pas étonnant qu’on ait baptisé leur musique : « Surf Music ». Un genre qui influencera beaucoup de groupes parfois aussi éloignés de la Californie que le Who. Autour des Beach Boys et de leurs chansons se construit alors le mythe d’une Californie idyllique, pleine de soleil, de surfers, de jolies filles et, plus tard de drogues à effets psychédéliques. Pourtant, dès le milieu des années soixante, les Beach Boys seront plus concernés par leur rivalité avec les Beatles que par le folklore des plages. Ils se convertirons ensuite à diverses formes de mysticisme oriental et leur musique perdra de son impact. Elle reste tout de même inégalée à ce jour tant par la beauté de ses harmonies que par la compréhension intuitive du milieu dans lequel elle est née.
Quelques albums à (ré)écouter :
Pet Sounds (1966) : est le onzième album de studio du groupe de rock américain The Beach Boys. Il a d’abord rencontré une réponse critique et commerciale tiède aux États-Unis, atteignant la 10ème place au Billboard 200, une place sensiblement inférieure à celle des albums précédents du groupe. Au Royaume-Uni, l’album a été salué par sa presse musicale et a été un succès commercial immédiat, 2ème au UK Top 40 Albums Chart et restant au top Top 10 pendant six mois. Pet Sounds a ensuite été récompensé mondialement par des critiques et des musiciens, et est largement considéré comme l’un des albums les plus influents de l’histoire de la musique. Il contenait des arrangements orchestraux luxuriants et sophistiqués qui ont permis au groupe d’entrer dans le cercles des plus grands innovateurs du rock.
L’album a été produit et arrangé par Brian Wilson, qui a également écrit et composé presque toute sa musique. La plupart des sessions d’enregistrement ont eu lieu entre janvier et avril 1966, un an après avoir quitté les tournées avec les Beach Boys afin de se consacrer à l’écriture et l’enregistrement. Pour Pet Sounds, l’objectif de Wilson était de créer «le plus grand album de rock jamais réalisé» – un travail personnalisé sans musique de remplissage. Il est parfois considéré comme un album solo de Wilson, en répétant les thèmes et les idées qu’il avait introduites avec Today! un an plus tôt. Le single principal de l’album, « Caroline, No », a été publié comme ses débuts officiels solo. Il a été suivi par deux singles crédités au groupe: « Would not it be Nice » et « Sloop John B ».
Smiley Smile (1967) : Ce disque est une reprise du projet de l’album Smile sur lequel Brian Wilson connut de nombreux problèmes techniques de réalisation, des réticences de Mike Love qui refusa d’y collaborer mais aussi des divergences avec la maison de disques. Les problèmes mentaux de Brian, amplifiés par les drogues et la pression du résultat, à une époque où le groupe était en concurrence directe avec les Beatles, n’arrangèrent pas les choses et le projet Smile fut abandonné par les membres du groupe. Les diverses ébauches enregistrées furent regroupées dans Smiley Smile qui sortira en mai 1967. Smile marque le déclin de l’influence de Brian Wilson dans le groupe. Cloîtré dans son lit, paranoïaque et devenu obèse, Brian Wilson ne participera plus que de manière sporadique aux Beach Boys et il faudra attendre 1976 pour qu’il revienne au sein de la formation, avec l’album 15 Big Ones.
Smiley Smile est le premier d’une série nombreux albums des Beach Boys qui furent des échecs commerciaux, mais c’est devenu un disque culte dans l’œuvre de Beach Boys. Pour redorer son blason lors de la sortie de Pet Sound, le groupe avait demandé les services de l’ancien attaché de presse des Beatles, Derek Taylor. Fatigué d’être perçu comme un groupe désuet, le leader et auteur-compositeur Brian Wilson avait demandé à Taylor de donner une nouvelle image aux Beach Boys et de les transformer en icônes de la contre-culture à la mode, avec une campagne promotionnelle dont le slogan était « Brian Wilson est un génie ».
Prophétie auto-réalisatrice puisque dans son livre sur la musique psychédélique, l’auteur Jim DeRogatis a fait référence à Smiley Smile comme à une « pièce maitresse de l’ultime discothèque du rock psychédélique ». À un moment donné, il fut même utilisé par certains centres de réadaptation pour aider à soulager les effets secondaires des expériences psychédéliques intenses. Le disque contient un seul tube, mais son succès fut immense. Il s’agit de « Good Vibrations » sorti en single en octobre 1966.
Still Cruisin’ (1989) : est le vingt-sixième album studio des Beach Boys. En 1988, les Beach Boys redeviennent numéro 1 des charts avec Kokomo, extrait de la bande originale du film Cocktail avec Tom Cruise. C’est leur premier n°1 depuis « Good Vibrations » en 1966. L’album Still Crusin’ réunit « Kokomo » et « Wipe Out », déjà sortis en single l’année précédente, et trois nouvelles chansons : la chanson-titre, « Somewhere Near Japan » et « Island Girl ». Le succès de « Kokomo » l’année précédente a ramené les Beach Boys sur le devant de la scène, et Still Cruisin’ devient rapidement disque d’or.
Depuis la sortie de Still Crusin’ en 1989, les Beach Boys continuent de tourner malgré une formation qui n’a plus rien à voir avec celle des origines. En effet en 1983, Dennis Wilson, s’est noyé accidentellement à Marina Del Rey à Los Angeles. Le groupe est séparé de Brian Wilson depuis 1988. Carl Wilson est décédé d’un cancer du poumon en 1998. Al Jardine a quitté le groupe après la mort de Carl et Mike Love est désormais le seul membre originel des Beach Boys (Bruce Johnston étant arrivé en 1965).
Les Beach Boys ont accédé au Rock & Roll Hall of Fame dans la catégorie interprètes en 1988.
Discographie :
Surfin’ Safari (1962)
Surfin’ USA (1963)
Surfer Girl (1963)
Little Deuce Coupe (1963)
Shut Down Volume 2 (1964)
All Summer Long (1964)
The Beach Boys’ Christmas Album (1964)
Today! (1965)
Summer Days (and Summer Nights!!) (1965)
Beach Boys’ Party! (1965)
Pet Sounds (1966)
Smiley Smile (1967)
Wild Honey (1967)
Friends (1968)
20/20 (1969)
Sunflower (1970)
Surf’s Up (1971)
Carl and the Passions – « So Tough » (1972)
Holland (1973)
15 Big Ones (1976)
Love You (1977)
M.I.U. Album (1978)
L.A. (Light Album) (1979)
Keepin’ the Summer Alive (1980)
The Beach Boys (1985)
Still Cruisin’ (1989)
Summer in Paradise (1992)
Stars and Stripes Vol. 1 (1996)
Smile (2011) enregistré en 1966-1967
That’s Why God Made the Radio (2012)
Voir sur YouTube : « The Beach Boys – Kokomo [HD] » par Alejandro Ulloa ; « The Beach Boys – Still Cruisin’ (1989) » par ClassicVideos80s ; « The Beach Boys – Wouldn’t It Be Nice (Original Video) » par Solrac Etnevic ; The Beach Boys – I Get Around par John OneCOne
https://www.youtube.com/watch?v=1xZ3HW8GWAU